
C’est la première véritable belle journée de l’année et tout ce que Montpellier compte de bipèdes est venu s’échouer sur le banc de sable le plus cher de France.
C’est la foule des grands jours d’été qui se répand dans les ruelles et envahit le front de mer. Du côté de la marina, les bourgeois du centre-ville cossu se battent pour les dernières tables des restaurants de coquillages. J’observe la course continue du maitre de salle qui jongle entre les exigences des uns, les annexions des autres et les désertions des réservations qui arrivent en retard, finalement. Il y a cette femme, en robe de créateur, chapeau du prix de Diane vissé sur son crâne de rentière qui exige ce qui lui revient de droit et toute cette famille de joyeux prolétaires qui débarquent à grand bruit pour s’offrir leur grand banquet de l’année.
Le long du canal, c’est la petite classe moyenne qui prend ses quartiers de printemps, coincée entre les franchises alimentaires qui dépotent de la nourriture standardisée à la chaine et les attroupements des Palavasiens autour de leurs candidats venus secouer de la paluche de brave électeur docile. Ici, les chefs grisonnent et l’on regarde d’un air suspicieux les promeneurs descendus de la métropole régionale, principale source de revenus du bled… et d’exaspération des riverains. Ces touristes que l’on aime détester, mais qui financent les petites douceurs quotidiennes des autochtones. Si la rive gauche est le fief du maire sortant, la rive droite a blanchi sous les embruns et se plaint des envahisseurs tout en faisant mine d’ignorer le petit bouquet constipé des représentants du FN.
De-ci, de-là, les derniers pêcheurs palabrent autour de leur étal où agonisent leurs prises du petit matin. J’aime bien le port de pêche, ses petits artisans, ses écailleurs qui vident les poissons aux ouïes bien rouges d’un couteau expert. C’est presque un musée folklorique en plein air, le souvenir d’une époque où le poisson ne sortait pas sous forme de bâtonnets de bateaux-usines qui reviennent de piller le bout du monde et des océans.
Un peu plus loin, sous le ciel d’un bleu blessant, les files s’allongent devant les glaciers, les marchands de frites, de sandwichs et de petite restauration sur le pouce. C’est le fief des familles avec jeunes enfants, des jeunes couples en goguette, des impécunieux venus prendre leur part de soleil et de bon air. C’est aussi le territoire de chasse de tous les oiseaux marins du secteur, lesquels jouent aux chaises musicales sur les mats de l’école de voile en attendant le signal de la curée. Ici se retrouvent les habitants de La Paillade et des autres quartiers dits sensibles du district. Mais en fait de racailles, stigmatisées en leur temps par un président en mal de petits vieux peureux, la promenade est encombrées de poussettes où de petits tyrans de moins d’un mètre réclament à grands cris leur gouter de villégiature.
Ce que fait mine d’oublier le sociologue des quartiers, c’est que jeune de banlieue
n’est pas un statut, mais seulement un état transitoire, à peine plus inconfortable que celui de petit con des beaux quartiers. L’âge ingrat s’offre les indignations qu’il peut, et pendant que le petit bourgeois piaffe d’impatience à la perspective de reprendre l’héritage familial, les petits prolos de banlieue tournent en rond et éclatent de colère en attendant de trouver leurs propres places au soleil.
Les casseurs de 2005 ont à présent la petite trentaine familiale, ils ont réussi comme ils ont pu à surnager dans un océan de mépris et de précarité et aujourd’hui, ils allongent l’après-midi bleue et or comme n’importe qui d’autre en payant une somptueuse glace aux Schtroumpfs à leurs enfants qui coursent les mouettes en piaillant.
Les ombres s’allongent sur la jetée et les jeunes mères houspillent les gosses récalcitrants à renfiler leurs chaussures après cet avant-gout d’été. Les mouettes et les goélands se disputent l’accès aux poubelles débordantes d’emballages bien gras et sucrés et parfois, un oiseau plus chanceux que les autres s’envole en tenant fermement dans son bec un chichi ou une moitié de sandwich abandonné par un petit ventre aux trop grands yeux.
La fraicheur subite rappelle que nous ne sommes qu’à la fin d’un hiver trop gris et le front de mer se vide brutalement, précipitant des milliers de familles vers un énorme amalgame d’acier et de gaz puants immobiles, embouteillage monstre dont les résidents raconteront des jours plus tard qu’ils n’en ont jamais vu de pareil, même au cœur du mois d’aout.

 Faire un don en Ğ1
Faire un don en Ğ1
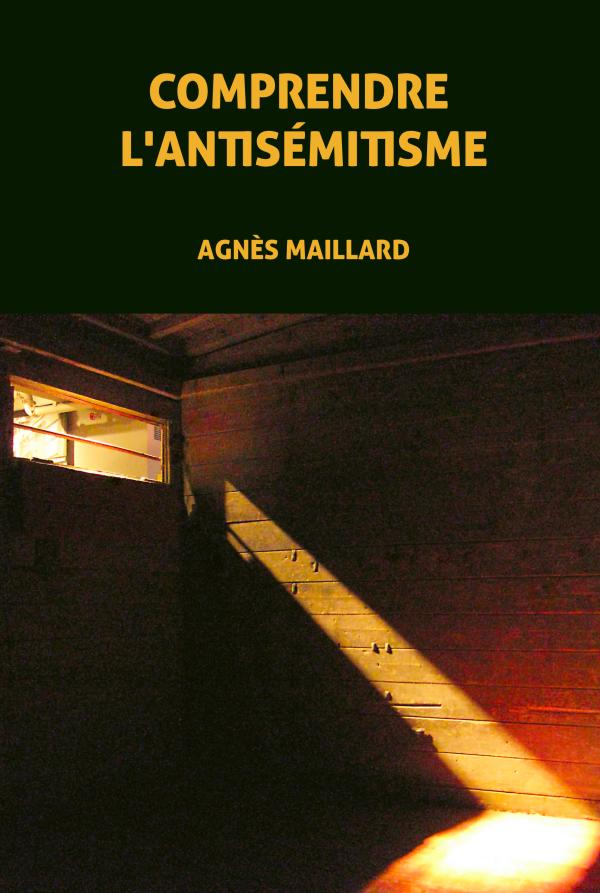
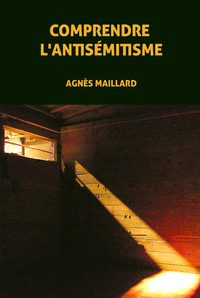




Et jusqu’à quand le Monolecte reste dans les parages ? Se pourrait-il qu’il partage un verre avec le vieux singe ?
Désolée, je raconte dimanche dernier, sa journée à la plage et son embouteillage centenaire dont tout le monde a dû parler cette semaine. J’étais juste en visite familiale pour le WE. Et vu la rareté des visites à mon père (pour cause de chèreté de tout, de l’hébergement à la nourriture), quand je viens le voir, ce n’est que pour le voir… sur son foutu banc de sable!
Sinon, ça aurait été avec plaisir, vraiment!
Dimanche dernier, j’arpentais les flancs de l’Etna. Mais dès que je passe dans le grand Sud-Ouest, c’est moi qui t’appelle ! A bientôt,
Cochon qui s’en dédit!
Ça roule.
Et bon dimanche encore au soleil…
Beau comme un papier d’emballage huileux de mayonnaise brillant de mille feux sous le soleil printanier,
De la foule en goguette et des sauvageons :
« Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant
Pour chasser l’enfant, pas besoin de permis
Tous le braves gens s’y sont mis »
Source : http://www.generationreactive.com/la-chasse-%C3%A0-lenfant-par-jacques-pr%C3%A9vert
Dans ma jeunesse, on avait inventé le concept de « bande de jeunes » et individuellement, celui de « loubard » – étymologiquement « loup » suivi du suffixe péjoratif « ard », prédateur des bas quartiers. Dans l’inconscient collectif de l’époque, les bandes de jeunes se déplaçaient à moto, écoutaient du rock et allaient de bal en bal pour provoquer des bagarres. Le loubard opérait seul, il volait des voitures, se livrait à des trafics d’auto-radios et de pièces mécaniques, s’attaquait aux petites vieilles de retour de la poste chercher leur petite retraite. Il portait un Perfecto et était reconnaissable à sa mobylette trafiquée. Forcément il habitait une de ces cités que la gauche de l’époque appelait « silos à main d’oeuvre » ou encore « cités-dortoirs », et que ceux qui y vivaient qualifiaient de « zone », eux-même se reconnaissant dans le terme de « zonards » qui depuis, est devenu un qualficatif répulsif désignant les SDF à chiens, jeunes, alcooliques et menant une vie errante. encore jeunes. Avant ce foklore à la Renaud encore empreint de réminiscences des années 50, on avait les blousons noirs et dorés (les noirs étaient les rockys prolétariens qui se la jouaient James Dean, les dorés étaient les fils de bourges encanaillés à force d’oisiveté ; encore avant il y avait les Apaches, et encore encore avant les gouapes, les jocrisses, etc.
Cette petite échappée historico-linguistique pour dire qu’il y a toujours eu une partie de la société qui a posé problème à celle-ci après qu’elle l’ait mise à l’écart, et il y a toujours eu des mots pour distinguer cette partie de la société du gros du troupeau, évidemment irréprochable.
Aujourd’hui on a le « jeune de banlieue ». Souvenons-nous que la banlieue était à l’origine un faubourg où vivaient ceux qui étaient mis au ban de la société, sorte de ghetto où cohabitaient ceux avec qui le bourgeois n’entendait pas se mélanger.
Le « jeune de banlieue », figure à laquelle on ne souhaite pas s’identifier, autour de qui se cristallisent toutes les craintes des braves gens, insécurité civile (ils vivent de trafics, ils ont des grosses cylindrées mais on leur refile le RSA, ils agressent les gens pour une clope refusée ou un regard de travers, les cités sont des zones de non-droit…) et insécurité sociale, car le « jeune de banlieue » symbolise aussi l’exclusion, le rejet dans les marges, la panne d’ascenseur social, le semi-échec des politiques d’intégration (pour une Rachida ou une Najat devenues ministres, combien de destins de RSAstes, de refus de postes, de logements « à la gueule du client », de contrôles flicards « au physique », de déclinaisons politocardes du fameux discours « du bruit et des odeurs » ?) et plus globalement, la sclérose d’une société française vieillissante et frileuse, qui faute de savoir se remettre en question s’englue dans le flicage et la bureaucratie, la stigmatisation de ceux qu’elle rejette dans les marges et la gestion au jour le jour de la misère de masse, le clientélisme politicien d’un côté et de l’autre, le rejet des élites que l’on continue cependant à élire – attitudes contradictoire et inconciliables qui signent l’éclatement d’une société dont le principal bouc émissaire est ce « jeune de banlieue », souvent d’origine afro-arabe, qui vaut, lorsqu’il exprime une révolte de quelque manière que ce soit, pour un retour de boomerang du colonialisme et de la trahison exercée sur les harkis.
Pendant que je regardais toutes ces familles vivre une après-midi familiale tranquille, je repensais à mon père. À 20 ans, il avait une bande de potes, il allait de baloche en baloche pour draguer et se taper des bagarres avec une bande ennemie, il se coiffait les cheveux comme James Dean auquel toutes les filles disaient qu’il ressemblait et se tortillait pour rentrer dans son jean’s serré.
Moi, ce que j’ai connu, c’est un gars qui avait la tronche du capitaine Stubing, qui ne sortait de ses costards 3 pièces que pour son uniforme short – tongs – bob pour m’amener bouffer des gauffres au Luna Park…
En fait, une trajectoire tout à fait classique…
Joli cet historique JB !
Aujourd’hui, il n’y a pas que la qualification des mis à l’écart qui agit à leur encontre mais aussi et surtout, via l’interpolarité sociale véhiculée par la prégnance incessante des médias, un disfonctionnement tragique dans la solidarité qui les fondaient.