Je viens d’un pays banal où les fenêtres ont des oreilles et des rideaux qui se soulèvent sans aucune brise.
 C’était un monde d’une extrême bienveillance où une foule invisible de braves gens veillaient en permanence à ce que je ne sorte jamais des sentiers bien balisés. Rien n’était jamais dit, mais tout se savait.
C’était un monde d’une extrême bienveillance où une foule invisible de braves gens veillaient en permanence à ce que je ne sorte jamais des sentiers bien balisés. Rien n’était jamais dit, mais tout se savait.
— Mais que faisais-tu à trainer avec le petit Barabas ?
C’était ma grand-mère qui m’alpaguait au moment où je rangeais mon vélo dans l’abri du jardin. J’étais, d’une certaine façon, plus libre que les enfants d’aujourd’hui puisque je pouvais trainer avec la bande du quartier loin du regard de ma grand-mère. Mais d’un autre côté, elle avait trouvé, comme tout le monde dans le bled, d’aimables extensions à ses yeux myopes et quoi que je fasse, quoi que je dise, tout lui était rapporté dans la minute par quelque ésotérique moyen de communication qui enfonçait, de loin, la mythique barrière de la vitesse de la lumière.
Le petit Barabas, comme bien d’autres, faisait partie des mauvaises fréquentations. Non pas qu’il fut particulièrement plus turbulent, chahuteur, menteur, voleur, tricheur ou déconneur que la moyenne des gosses du quartier, mais c’est qu’il venait d’une famille à la mauvaise réputation et que ce seul fait suffisait à lui régler son compte de manière définitive.
C’est qu’ils ne vivaient pas vraiment comme tout le monde, ces gens-là. Et puis, d’ailleurs, qui savait réellement ce qu’ils trafiquaient dans leur coin ? Et la mère, pour qui elle se prenait, avec ses grands airs, à ne saluer personne les rares fois où elle descendait en ville ?
J’avais dans l’idée qu’elle avait bien dû tenter de briser la glace deux ou trois fois et qu’elle avait fini par laisser tomber, rabrouée par la morgue malveillante des commères du village, les gardiennes du temple de la moralité, celles qui faisaient ou défaisaient la réputation des uns et des autres en quelques mots expéditifs.
Malheur aux différents ! Malheur aux pas comme nous
! Ils se retrouvaient murés vivants dans une gangue de mépris et de suspicion qui les isolaient plus surement du reste de la communauté que s’ils avaient vécus sur la Lune.
C’était con, parce que j’ai toujours préféré la société des marginaux, des pas pareils
, des pas fréquentables
, de ceux devant lesquels on change de trottoir et on baisse la voix en chuchotant. Pas juste parce qu’ils étaient des réprouvés, pas juste par esprit de contradiction — encore que, quand même, un peu —, mais par envie d’aller vers ce qui n’est pas connu, reconnu et balisé, ce qui n’a pas reçu l’approbation normative des vieilles barbues à l’haleine fétide et aux idées étroites.
La bonne société des mouflets de mon âge, c’était les premiers de la classe, les gosses de notables et de commerçants, souvent de remarquables petites pestes suffisantes et cruelles que je jugeais précisément totalement infréquentables. L’entre-soi déjà moisi du mépris social. Les mauvaises fréquentations, c’étaient les immigrés, les gosses d’ouvriers et de prolos, ceux dont les parents ne frayaient pas avec les braves gens du bled, quitte à pochetronner jusqu’à pas d’heure au troquet du coin où j’allais régulièrement chercher mon grand-père. J’étais juste au milieu de ce bel ordre social, avec une assez bonne réputation, entachée par ma tendance à préférer les infréquentables. Bonne élève, plutôt mignonne et gentille, même si j’avais déjà ce que les commères appelaient paradoxalement une langue bien pendue, c’est-à-dire non pas un organe à baver interminablement sur autrui, mais une manière plutôt impertinente de poser les mauvaises questions au mauvais moment et aux mauvaises personnes.
Même ça, même ta tronche était un enjeu central du contrôle social : pas de place pour les moches, ou alors en braves souffre-douleur, ni pour les trop belles, forcément des putes et des Marie couche-toi là
. Tout était tellement soigneusement pesé, calibré, référencé, rapporté, comparé et archivé : la longueur de la jupe, ni trop haute (ça fait pute) ni trop basse (ça fait romano), si tu souris juste assez, ni aguicheuse, ni hautaine, l’heure à laquelle tu sors, celle à laquelle tu rentres, à qui tu parles, où et comment… tu es juste comme un insecte dans un labyrinthe de verre.
Je ne sais pas trop comment, mais ça a continué plus tard, après, même (et surtout) quand je suis partie à la fac, loin dans la ville. C’est ça, la magie du village : loin des yeux et près du cœur.
Un jour ma grand-mère m’appelle, en colère et affolée :
Tu dois rentrer tout de suite à la maison.
Je ne peux pas, j’ai partiels !
Arrête de mentir, je sais tout !
Arf, qu’est-ce que le téléphone arabe du bled avait bien pu trouver à lui rapporter d’au-delà des frontières lointaines de notre grande ruralité ? Que je fumais comme un pompier, que je picolais parfois comme un Polonais (et même avec, quand la soirée était bonne), que j’avais des potes qui se camaient, d’autres qui vendaient leur cul pour arrondir leurs fins de mois, que ma résidence universitaire regroupait tellement de nationalités différentes qu’on aurait pu se croire à une séance plénière de l’ONU, que je trainais dans les quartiers louches à des heures indues et qu’il m’arrivait de piquer du nez en cours après des nuits plus longues que des jours sans pain ?
Tu sais quoi ?
Que ce n’est pas vrai, que tu n’es pas à l’université. On m’a dit que le Mirail, c’est une cité HLM et que tu y vas te faire sauter par des bougnoules. On ne met pas d’université dans les banlieues, tout le monde sait ça.
Le weekend suivant, je lui ai rapporté ma carte d’étudiante, celle de la BU, les tickets RU, des brochures de la fac, des notes de cours, tout ce que j’ai pu trouver. Plus tard, je lui ai même ramené un diplôme, puis un autre d’une fac plus prestigieuse. Et encore un autre. Mais cela n’avait aucune importance. Je crois bien qu’elle est morte en n’ayant absolument jamais rien compris de ce que je suis, de ce que je pense ou de ce que je fais de ma vie. Elle m’a toujours demandé si j’allais avoir un jour un vrai boulot, un vrai métier et une vraie famille. Des choses simples et faciles à comprendre. Des choses comme tout le monde, des choses comme font les gens bien.
Les gens qu’on a envie de fréquenter, dans son monde.

 Faire un don en Ğ1
Faire un don en Ğ1
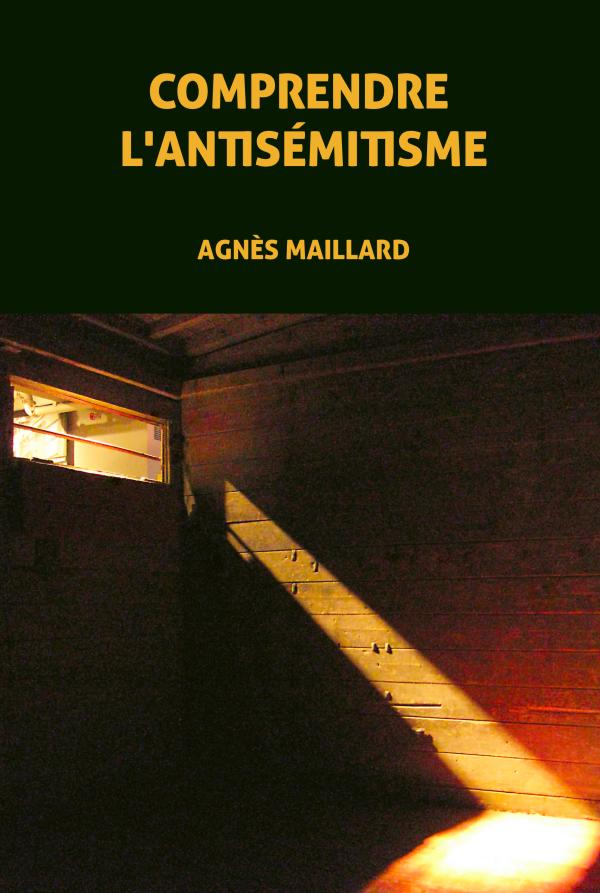
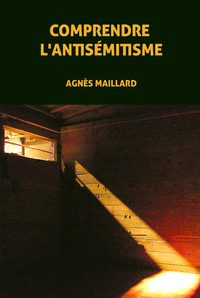


Dis donc, t’aurais pas été un peu moi, toi ?
Très beau (même si c’est très moche)
Toujours aussi splendidement écrit !-)
Et : Oui, ça fait flipper.
Très beau texte qui me fait penser à la chanson de Brassens "Les mauvaises fréquentations"…
Ah les mauvaises fréquentations !
Gamin, et très au-delà, j’ai été pratiquement emprisonné dans le périmètre de la ferme. Ma mère avait failli être enlevée à 13 ans, par un type dont elle avait cru qu’il cherchait son chemin. Donc les enfants n’avaient le droit de sortir seuls que pour l’école et le catéchisme. Encore fallait-il ne pas traîner en chemin au retour, faute de quoi les punitions tombaient dru, et les reproches également. Moi aussi j’avais une grand-mère horrible. La vie était déjà spartiate, avec ce genre de personnage c’en était encore plus dur.
C’est pourquoi, adulte, je les ai tous haïs, ces gens de la terre si tatillons, et dont je me suis bien rendu compte qu’ils ne m’avaient rien appris de la vie. Alors, à quoi bon ?
Un signe qui ne trompe pas : de mes propres enfants, vivant assez loin, j’ai des nouvelles presque tous les jours. "Le courant passe", comme on dit. Et de fossé, il n’y en a guère.
ya une erreur : les gosses de notables et de commerçants n’étaient pas les premiers de la classe, mais souvent les derniers. De toutes façon, ils feraient notaires ou entrepreneurs de TP comme papa !
Parce que ces vies de merde passées "derrière le rideau" sont parfois celles de proches, on y cherche en vain des mobiles qui puissent en être des excuses. Il n’y en a pas.
Inutile d’y user l’énergie, lutter pour y échapper est une tâche bien suffisante au quotidien.
Texte touchant effectivement, que chacun peut s’approprier à sa façon, et faire naitre la question suivante : existera-t-il un fossé aussi grand entre nous et nos futurs petits-enfants?
Aujourd’hui, grand-mère ouvre un compte facebook pour suivre ses petits enfants
enfin… tout le monde sait que le bonheur est dans le pré…
Ta grand mère me fait penser à … mon père qui était un infâme tyran. Et comme j’en avais une peur bleue, tel un hérétique qui sait qu’il va être soumis à la Question, je l’ai haï pendant très longtemps. Je me souviens avoir tout de même pleuré à son enterrement. Qu’est-ce qu’on peut être con !
Moi, je sais pas si c’est vrai ou si c’est les mauvaises langues, mais…y paraît qu’elle suce, Picion !
ça me rappelle plein de choses. m’enfin dans mon cas je suis fille de divorcés ("ha ça vous pouvez être sûrs que ça deviendra une pute, hein!") du coup je suis celle sur qui il ne fallait pas miser, on a très vite fait son deuil de moi (pas de cadeaux d’anniversaire, pas de communication, etc) et on ne m’a donc pas subventionnée ni pour les études ni même pour un permis de conduire ou une bagnole, la daronne a suivi (ou initié) le mouvement, et de fil en aiguille et bin bonjour la prophétie auto-réalisatrice, j’ai pas fini pute mais précaire aggravée à vie de merde sur qui tout un chacun a tenté d’user et abuser de son petit pouvoir puisque voyant bien qu’il n’y avait aucune protection, ça oui.
merci la famille.
devrait y’avoir un permis de procréer, picétou.
@totolezheros : malgré la virgule, la phrase est en effet ambivalente. La bonne société, c’était les premiers de la classe ET les gosses de notables. C’était effectivement rarement les mêmes. Les gosses des notables profitaient sans vergogne du pouvoir et de l’argent de leurs parents et savaient depuis toujours qu’ils n’avaient pas besoin de se faire chier plus que cela en classe, il leur suffisait de grandir pour pouvoir récupérer l’affaire de papa. Les premiers de la classe, c’étaient souvent les gosses de profs, correctement drivés à la maison et dont les stratégies scolaires étaient parfaitement maîtrisées par la parentèle. Mais il y avait des gosses de prolos de ma sorte, ceux dont les parents avaient réussi une petite ascension sociale à la force du poignet, accédant à la qualification, voire la maîtrise, des gens qui misaient tout, absolument tout, sur l’ascenseur social de l’Éducation Nationale. C’est dire si on était des gens méritants, voire exemplaires et à quel point il fallait bien se tenir et être reconnaissants à l’ordre de social d’avoir bien voulu nous céder un strapontin qu’il ne fallait pas lâcher pour tout l’or du monde.
Nous avons, bien sûr, été les premiers sacrifiés sur le grand autel de la Crise Perpétuelle, mais c’est une autre histoire…
"les mauvaises questions au mauvais moment et aux mauvaises personnes."
Tu veux dire "les bonnes questions, au bon moment, aux bonnes personnes"?
Chaque fois que tu parles de ta grand mère, ça me fait le même effet, je peux pas m’empêcher de l’aimer… et j’arrive pas trop à m’expliquer pourquoi.
Le coup du Mirail et de la grand-mère, c’est hallucinant…pourquoi vous ne l’avez pas envoyée chier, la vieille bique (si vous me passez cette expression un peu libre) ?
En tous cas un bien beau témoignage pour les nostalgiques d’un c’était mieux avant qu’ils n’ont, bien sûr, pas connu.
Mmm,
J’ai pas connu ça…
Bon, je dis pas, y’avait des boucs émissaires, des pouilleux et tout ce qu’on voudra, mais la division était ailleurs.
Dans mon école, c’était la guerre des boutons. l’est du village contre l’ouest, en bande organisée qui construisait des cabanes dans les bois et détruisait celles de l’autre "clan" quand elle les dénichait.
Le tout avec tout son lot de traitrises… certains du centre du village, pouvant passer à l’ennemi du jour au lendemain.
Et tout ce petit monde s’unissait face à l’école du village d’à côté, les jours de piscine ou de sortie scolaire…
Dans cette organisation, tout le monde avait sa place. Même les "pouilleux".
Les mauvaises fréquentations, ce n’était alors pour moi qu’une chanson de Brassens.
Et lorsque nous avons eu des poubelles déversées dans notre jardin (mon père ayant distribué des tracts communistes), je n’ai jamais lu sur les visages de mes camarades d’école la moindre défiance.
La guerre sévissait entre adultes, mais les enfants n’en subissaient pas la pression…
Comme quoi, c’est pas une généralité.
Ce qui m’a d’ailleurs appris la confiance en autrui super jeune.
Aujourd’hui, c’est autrement plus corsé. Je connais très peu de monde qui laisse vagabonder ses enfants à leur guise dans le village, et faire leur vie entre eux.
La peur l’a emporté sur la confiance.
Ceci dit, là où je voulais en venir, c’est que je ne pense pas que ces jugements sur les bonnes et les mauvaises fréquentations soient la règle. Il existe, et c’est heureux, suffisamment de gens qui ont l’esprit ouvert pour contrebalancer cette tendance archaïque.
Tu as écrit un jour un article sur le contrôle social : https://blog.monolecte.fr/2006/…
Le contrôle social est je pense un reste de comportement tribal qui fait qu’un village maintient l’ordre dans ses rangs. Ça peut avoir de bons côtés, mais quand ça dérape, ça devient l’enfer pour qui ne rentre pas dans le moule.
@Juan : tu vois, il y a bien des choses universelles que nous partageons tous.
Le retour!
Sympa comme texte… oui, cela me rappelle le Costa Rica et ces bonnes familles.
Ce texte fait du bien.
La volonté de vivre ce que l’on est individuellement terrifie les sociétés.
Les qualités acquises y sont jalousées sinon incomprises, les erreurs produites y sont persiflées voire fantasmées à l’outrance.
C’est une soumission conduite uniquement sur nos peurs plutôt qu’avec nos sentiments et notre intelligence particulière.
j’aime beaucoup vos textes 🙂 pour ajouter mon témoignage, je faisais partie des filles de profs en école primaire, tout le monde voulait etre mon amie. puis arrivée au collège, certaines jalouses m’ont rattrapé et mis la disgrace.mon frère meme tarif. pour le lycée j’ai déménagé dans une grande ville, la j’ai enfin pû vivre un peu ! je ne sais pas si c’est pareil dans l’anonymat des villes… le monde rural changera t il un jour ? ou bien la transmission est elle trop forte ?
@ Jésus Crie
Rue Crébillon…. effectivement c’est l’endroit où se retrouvent les Marie-Chantal Du Pied De Grue. Celles qui habitent de charmantes impasses "réservées aux riverains" du côté du Boulevard Guist’Hau, je suppose.
J’aime mieux l’ambiance au pied de la tour de Babel de l’ouest, tellement plus haute en couleurs et en sons…. ce n’est déjà plus tout-à-fait Nantes. Un homme politique français aux fonctions importantes actuellement y a habité, il y a 40 ans.
Le coup de changer de trottoir ça me rappelle une histoire, vraie bien sûr, déjà ancienne.
Une histoire de grande ville comme quoi, ville, campagne, c’est pas foncièrement différent.
C’est une dame de la haute, elle vient d’adopter une petite fille. Chez « ces gens-là », adopter, introduire un sang étranger dans la lignée, nuire à l’héritage, mais non mais non ça ne se fait pas.
Elle est aussitôt ostracisée, plus invitée… et s’en moque comme de son premier col Claudine. Jusqu’au jour où, remontant bébé au bras la rue Crébillon (on aura compris que je parle de Nantes la complexe), elle voit au loin un ex-machérie changer de trottoir. Elle continue de monter et, au dernier moment, la rejoint sur son trottoir et la salue avec un sourire vengeur.
Dans ta gueule, Madame de.
Cela dit, ça va bien ensemble : la mauvaise réputation, c’est celle que l’on choppe moins par ses actions que par la contamination symbolique de ses mauvaises fréquentations 🙂
Une sorte de bléno sociale et magique!
@ Myriam de Huy #3
La chanson de Brassens, c’est "La Mauvaise Réputation", pas "Les Mauvaises Fréquentations" !
Merci, @amemar : c’est en vous lisant que je me rappelle pourquoi j’écris encore 🙂
Les "ceuses" qu’il fallait pas fréquenter dans mon patelin de quand j’étais petite, c’était les enfants d’immigrés. Les parents, de toute façon, c’était comme qui dirait des "domestiques" et "on ne parle pas à ces gens là"; Bref, les gamins allaient à l’école et on pouvait quand même par faire comme s’ils existaient pas, donc il fallait les "fréquenter" ! Certains devenaient bien entendu des souffre-douleurs bien pratiques, on risquait pas de se faire engueuler par les parents. Mais il y avait des risques; les maîtres (des saints laïques!) veillaient et celui qui était pris à tourmenter un camarade en prenait pour son grade. En ce temps là on n’allait pas chouiner dans les jupes des parents quand ça bardait avec le magister !
Ma famille arrivait du Portugal (1966) et j’avais 7 ans. 1 an pour apprendre à parler le Français, lire et écrire, 1 an de CE1-CE2, 1 an de CM1-CM2. Je me fais une copine : la fille du plus gros fermier du coin ! Sa grand-mère lui dit : "Vero, tu ne fréquentes pas Nati (Natividade !!) ses parents n’ont aucun bien au soleil !" Véro s’en moque car Nati est bien marrante et en plus, en classe, elle comprend tout plus vite que les autres et c’est bien pratique ! Bref deux copines la vie à la mort (celle de Véro décédée en 1998) , deux sœurs qui se sont choisies.
10 enfants dans la famille. Les 3 premières filles : premier prix au certificat d’étude (avec de super notes en Français,c’est un comble!) 10 diplômés du supérieur dont 3 doctorats, 5 enseignants et 2 chefs d’entreprises. L’ascenseur social à bien fonctionné on peut pas se plaindre! On pourrait croire que les gens du patelin seraient "fiers" de leur immigrés! Ben non! Lorsque notre instituteur est parti en retraite, il nous a avoué que certains villageois, ulcérés par nos bonnes notes, avaient écrit à l’académie pour dénoncer "ce gauchiste, qui n’aide que les étrangers"! Hé oui, c’est ça les petits bleds de bas de plafond, quand les enfants d’immigrés réussissent c’est soit de la triche, soit du favoritisme ! qu’ils soient simplement intelligents et travailleurs, cela ne leur vient pas à l’idée !
Si je vous ai raconté tout ça, c’est parce que j’ai retrouvé l’atmosphère de "lever de rideau" dans votre très beau texte, mais surtout parce qu’à ces gens, je voudrai leur rendre hommage : ils ont fini par être fiers de leur famille de "portos" et quand mes parents sont décédés, il y a quelques années, , l’église du village n’était pas assez grande pour accueillir tous ceux qui leur ont rendu un dernier hommage : les vielles bigotes, les bigotes entre deux-âges et les enfants de ces bigotes pour qui tous ces petits portugais étaient simplement de très bons amis. Et vous savez quoi, mon fils est à Science-po et Polytechnique ! Et lui il est pour eux un vrai français!!
Très honorée Madame Agnès !
Moi, j’ai le souvenir cuisant de ma première honte qui a changé mon regard sur les adultes qui m’entourraient.
Vivant en banlieue parisienne demi-chic à l’époque, dans une belle maison, avec une famille petite bourgeoise, j’avais environ 6 ans. Mes grands-parents tenaient un commerce, j’avais déjà 2 soeurs et j’allais à l’école privée du coin. Faute d’avoir le droit de sortir seule, je n’avais pas d’amie qui habitait assez près pour pouvoir aller jouer sous le marché couvert, grand bonheur de tous les enfants possédant un vélo ou des patins à roulettes.
En face de la maison, il y avait une rangée de petites maisons un peu délabrées dans les jardins desquelles je pouvais voir depuis le second étage de la nôtre où se trouvait ma chambre. Et, dans un des jardins, il y avait des petites filles avec qui j’aurais bien voulu nouer connaissance.
J’ai tenté ma chance un jour, en demandant à ma grand-mère si nous pouvions les inviter à venir jouer chez nous ou simplement à "faire des tours" sur la place du marché. J’avais envie de copines de mon âge, qui ne soient pas mes soeurs, trop jeunes et pas assez téméraires (garçon manqué, quoi).
Sa réponse et sa moue sont indélébiles dans mon esprit : "Ces gens-là ne sont pas fréquentables." J’ai bien perçu le dédain, le mépris pour la pauvreté et j’ai eu honte.
Mais pas pour moi, j’ai eu honte de ma grand-mère. Elle que je croyais si gentille s’était montrée peu charitable envers des enfants qui ne lui avaient rien fait, leurs parents non plus, d’ailleurs.
J’ai continué à regarder avec envie ces petites filles qui auraient pu devenir des amies pour tromper mon ennui, les années ont passé et un jour, les maisons ont été détruites pour rénover le marché. Sans doute étaient-ce des familles locataires, avec de petits revenus, tout simplement.
Ce rejet social a été déterminant dans la construction de mes choix de vie, puisque j’ai exactement pris le contrepied, au moins sur le plan personnel : je vais de préférence vers les différents, faibles, défavorisés et ai fait de la honte familiale d’avoir une soeur handicapée mentale une revendication pour que les choses évoluent dans ce domaine, entre autres.
C’est drôle comme un enfant perçoit tôt les "mochetés" et les analyse. Ma mère avait des différends fréquents avec ma grand-mère, je ne comprenais pas pourquoi mais tout s’est éclairé ce jour-là, ma mère se moquant du tiers comme du quart du qu’en dira t’on (elle a finit par "épouser un Arabe" après son divorce, j’aime autant vous dire que ça a fait du bruit pour l’époque !).
Je ne me suis jamais fâchée avec ma grand-mère, elle n’avait pas que des défauts et a été assez malheureuse elle-même pour que je sois indulgente, mais j’ai cessé de boire ses paroles à compter de ce jour-là.