Juste une poignée de mots, quelques inflexions de voix qui tintent aux oreilles et résonnent longuement en notre for intérieur comme une petite musique de l’âme, l’intimité incroyable d’une formule, d’un titre avec ce qu’il y a de plus secret en nous, une familiarité étrange et insaisissable, une pointe de jalousie pas franchement assumée face à l’un des plus beaux titres de la littérature mondiale, une quête intérieure et puis, un jour, la synchronisation parfaite, l’éclat de la compréhension, le moment où l’on acquiert la certitude que l’on sait exactement à quoi pensait l’auteur en écrivant ce titre à la puissance évocatrice incomparable : l’insoutenable légèreté de l’être
.
 J’ai lu le bouquin, j’ai vu le film. Au-delà de la folle passion amoureuse et de son déclin. Que je peux comprendre. Totalement. Mais j’ai toujours gardé une frustration diffuse quant au titre, tellement intime et intangible à la fois, comme une pensée qui plane à la lisière de la conscience, comme ce mot exact que l’on a au bout de la langue et qui s’effiloche dans le néant juste au moment où les lèvres s’enroulent pour le murmurer. Quelque chose de profondément futile et essentiel à la fois, le raccourci mental qui résume en quatre mots la substance d’une vie entière.
J’ai lu le bouquin, j’ai vu le film. Au-delà de la folle passion amoureuse et de son déclin. Que je peux comprendre. Totalement. Mais j’ai toujours gardé une frustration diffuse quant au titre, tellement intime et intangible à la fois, comme une pensée qui plane à la lisière de la conscience, comme ce mot exact que l’on a au bout de la langue et qui s’effiloche dans le néant juste au moment où les lèvres s’enroulent pour le murmurer. Quelque chose de profondément futile et essentiel à la fois, le raccourci mental qui résume en quatre mots la substance d’une vie entière.
Ne jamais rien prendre au sérieux pour ne pas se faire engluer dans les pesanteurs de l’âme humaine, rire de tout, surtout de soi-même et de ce qui nous blesse le plus, distancier la douleur, relativiser les sentiments, s’échapper de tout d’une pirouette ou d’un trait d’esprit, trouver la voie du juste du milieu, de l’abandon, du lâcher-prise. Mais ne jamais renoncer, non, jamais. Dépasser ses propres limites, celles auxquelles on s’enchaîne pour ne pas perdre pied, tendre vers le mieux, mais avec une grande indulgence. Ne pas se complaire dans la chute, dans la douleur, dans l’échec. Balayer les fâcheux dans un grand rire. Continuer. Savourer chaque instant, les bons, les doux, les tendres, les joyeux, mais aussi les âpres, les rugueux, les difficiles, les médiocres, ceux qui font mine d’être insurmontables et partir en quête du suivant, de l’autre côté de la moraine.
J’ai compris qu’il s’était passé quelque chose en regardant le vide entre mes pieds. Six mètres, ce n’est rien, mais pour moi, ça a toujours été bien trop. Je suis concentrée, arrivée en haut de la voie en quelques secondes. Vachée. Toujours rien. Ramener la corde vers son milieu. Ne pas laisser filer le brin. Équilibrer et passer dans le huit. Encore rien. Enrouler le machard. Validé par mon binôme. Remonter au-dessus de mon matériel et dévacher. Là, j’aurais vraiment dû ressentir quelque chose, mais non. Toute ma vie tient dans ma main droite et le double brin qu’elle ramène contre ma cuisse et je n’ai pas peur. Je n’ai même pas cette vague sensation d’apesanteur qui fait remonter la bile vers la glotte et tourner la tête. Rappel. Je glisse. Fluide. Libératoire. Comme je n’ai ressenti ni peur ni vertige, la semaine prochaine, je pourrai enfin monter en tête. Mais j’aurais dû sentir quelque chose, même un vague malaise.
Au moment où mes dents tirent sur le goulot rétractable de ma gourde, le couvercle cède et je me ramasse une large giclée de flotte en plein visage. L’effet de surprise me fait tanguer et je perds ma trajectoire rectiligne dans la descente caillouteuse. Ce n’était pas une bonne idée de boire dans la descente, mais je l’ai fait. Le vélo oscille d’autant plus dangereusement que c’est ma main gauche qui serre instinctivement le frein, ce qui est un très mauvais réflexe. Là, ça doit être la chute, je vais aller au tas et je vais bien trop vite pour que ça se passe bien. Les millisecondes s’étirent pendant que j’attends la fusion froide de la frousse qui tétanise les muscles et se fiche au creux des reins. Mais rien de rien. Le corps répond tout seul, la main relâche son étreinte en mode automatique, pendant que les jambes font balancier. Le vélo prend encore de la vitesse et les oscillations s’atténuent. Je ne m’arrête même pas. Je range la gourde entre mes jambes et je note mentalement que je n’aurais pas dû m’en sortir. Et je continue ma route.
J’ai toujours voulu tuer ma peur. La peur immonde qui empêche de vivre, qui broie les tripes et nous laisse, faibles et haletants, comme au réveil d’un cauchemar d’autant plus effrayant que l’on ne s’en souvient plus. Peur de faire, parce que peur de se planter. Peur de plaire, parce que peur du rejet. Peur d’exister, parce que peur du néant. Peur de vivre, parce que peur de mourir. La plus puissante des peurs, celle qui coupe le souffle et donne envie de hurler. La conscience ultime de notre finitude et de ce que ça implique : la fin de tout, l’absolue insignifiance de nos existences, de nos efforts dérisoires, de ce que nous faisons et de ce que nous évitons. Tous ces moments qui finiront dans le néant, comme s’ils n’en étaient jamais sortis. La chair, tiède et parfumée, la chair qui s’embrase ou se meurtrit, la chair qui nous connecte au reste du monde commence par nous trahir avant de nous lâcher. La chair qui pourrit et qui, ce faisant, amende le sol pour la génération suivante.
Même plus peur de crever. Ni peur de se tromper. Ne reste plus que cette insoutenable légèreté de l’être. Précisément. Cet état de grâce où s’ouvrent tous les possibles parce qu’il n’y a plus de freins. L’inconséquence ultime de l’humain qui ne pense même plus son lendemain. À force de me dépouiller de tout, il ne me reste même plus l’instinct de conservation. Et même ça, ça ne m’inquiète plus. Trop de temps sans avenir, trop de chemin sans horizon. À force de vivre comme l’oiseau sur la branche on se détache de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous entrave et nous maintient captifs des autres, du monde, de l’ordre social et de nous-mêmes.
N’avoir plus rien à perdre, c’est ne plus avoir peur et c’est être libre, forcément.
Les gloutons du monde qui s’accaparent toujours plus au dépens de tous ont oublié cette vérité humaine profonde.
Leur trouille doit être immense et son poids incommensurable doit les écraser au sol comme des ombres sous le soleil de midi.

Powered by ScribeFire.

 Faire un don en Ğ1
Faire un don en Ğ1
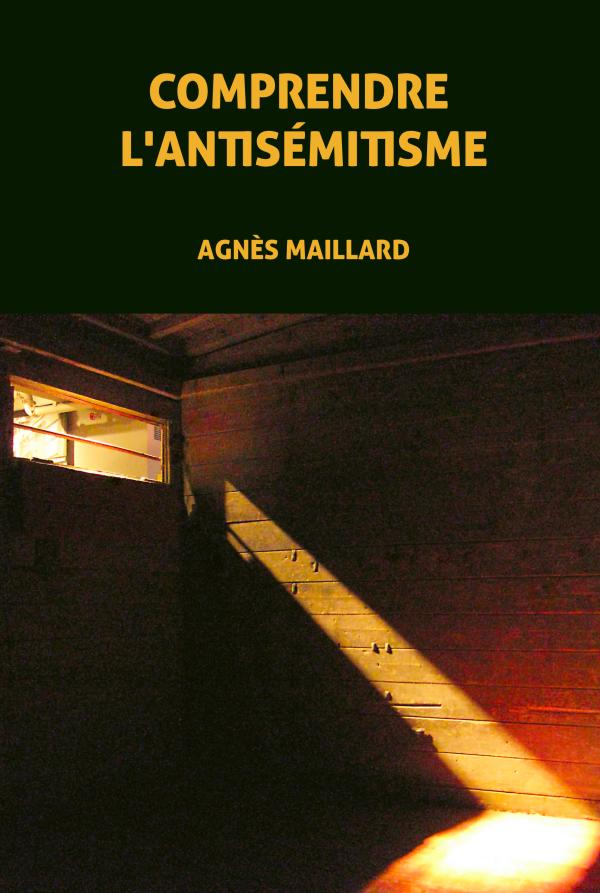
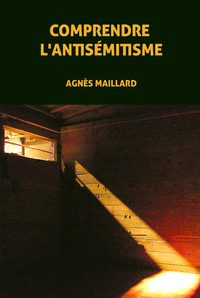


La masse silencieuse, si elle était vraiment libre aurait déjà renversé la tendance, et se serait déjà débarassée des gloutons du monde. Le problème, c’est qu’on a toujours quelque chose à perdre, aussi minime soit-il. Quand on nous ampute d’un bras, il reste encore l’autre à défendre. Et si celui-là aussi vient à être pris, il reste les jambes, etc… Les gloutons du monde sont suffisamment avisés pour ne pas tout nous prendre d’un coup, ou pour nous distraire avec de fausses idôles pour nous détourner de notre réelle condition. Je ne crois pas du tout que leur trouille soit immense, ni que son poids les écrase au sol, tant ils ont constamment l’esprit occupé à imaginer des stratagèmes pour ne pas perdre ce qu’ils ont. Ils n’ont pas le temps d’avoir peur.
"Je ne connaîtrai pas la peur car la peur tue l’esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l’oblitération totale.
J’affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu’elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n’y aura plus rien. Rien que moi."
Litanie contre la peur du Bene Gesserit – Dune (Frank Herbert) – http://fr.wikipedia.org/wiki/Bene_G…
Je me récitait ça en passant sur des ponts suspendus en Corse (j’ai un vertige terrible), mais je dois avouer que ça marche moyen…
ça me laisse songeur.
je n’ai pas lu ni vu le film. mais ce que vous dites me rappelle d’autres lectures de ma jeunesse, sur le bouddhisme entre autre. j’en espérais beaucoup. pas à l’égard de la peur. mais à l’égard du poids de la culpabilité qui me rongeais depuis l’enfance. j’ai trouvé d’autres voies plus occidentales pour m’en détacher, mais le travail est continuel car bien des choses dans la vie la font revenir.
j’apprécie les allusions vécues à propos de l’escalade et du vélo pour les avoir souvent vécues aussi. là effectivement, on expérimente dans l’action l’idée du lâcher prise, la confiance totale en son animalité qui n’a rien à faire de l’idée de finitude angoissante de la vie, de la crainte de l’échec, du déplaire etc…
et j’ai réinvesti tout ça très tôt dans ma recherche de contacts en matière de camaraderie comme d’emplois…
je suis toujours seul et j’endure régulièrement les rejets divers, pas toujours méchants, des gens dont on espère sympathie ou confiance pour un emploi.
ce que je note, ce n’est pas la peur de l’échec ou de la perte, mais la fatigue immense de l’insatisfaction permanente de la non répondance à toute main que je tends, à tous les pas en avant que je fais.
la fatigue immense qui conduit à ne plus vivre autrement que par automatisme, règle mécanique d’action : se lever, se toiletter, se nourrir, aller chercher des adresses, des annonces, des numéros de téléphone, faire des candidatures, prendre des contacts, proposer des services… tout ça pour rien à la fin…
alors les autres, ceux qui sont apparamment gagnants, battants, qui prétendent être acteurs de leur vie, et puis ceux qui effectivement proclament haut et fort leur foi dans l’individualisme conquérant, leur fierté et leur orgueil de volonté de puissance sur le monde, leur énergie à accumuler pouvoir ressources et capitaux… quand je les vois vivre, se battre, lutter, que ce soit contre un exploiteur ou contre un concurrent, relever des défis et dépasser leurs limites… il me vient effectivement qu’ils doivent vivre inconsciemment dans une terreur de l’autre, du monde, qui ne leur laisse aucun répis.
alors qu’effectivement, la vie, entre les feuilles des arbres, est d’une simplicité silencieuse évidente.
Encore un magnifique billet, Agnès.
Chapeau bas.
Ce titre m’a toujours fait rêver. Il y a longtemps que je connais le livre, que je sais de quoi il parle mais j’avoue ne jamais l’avoir lu. Comme quoi les mots véhiculent des images, des sensations et que le sens (que nous donnons aux choses) se cache souvent dans l’insaisissable. Peut-être aussi vaut-il mieux en rester là, juste à évoquer plutôt que de matérialiser à tout prix. Comme on dit, dans ces occasions-là, les paroles (ici les mots) sont inutiles.
J’ignore si tu t’intéresses à la physique, qui plus est à la physique quantique, mais, dans un ordre d’idées que je rapprocherai volontiers, vas donc écouter la vidéo (durées environ 1h30) que tu trouveras à l’adresse suivante :
http://vodpod.com/watch/1342713-que…
Au delà du verbiage scientifique nécessaire et des raccourcis (pertinents au demeurant) historiques, j’y ai trouvé une fraicheur « enfantine » qui n’est pas loin de « L’insoutenable légèreté de l’être ».
Amicalement
Cincinatus
Merci pour ce texte Agnès.
Je suis en train de lire Krishnamurti et Etty Hillesum et tu tombes à pic (sans mauvais jeu de mot!)
Une phrase d’Etty que j’aime beaucoup :
"Et puisque, désormais libre, je ne veux plus rien posséder, désormais tout m’appartient et ma richesse intérieure est immense"
J’ajoute l’insoutenable légéreté de l’être à ma liste de lecture (après le blog du monolecte 😉 )
Si être punk est être absolument et totalement désespéré, alors ce texte est effectivement très punk!
Un peu Punk tout ça… 😉
No future, etc. 🙂
Utiliser toute son énergie contre soi, ou contre les autres, ou pour une course en avant (vers des projets ambitieux)…
Oui, oui, oui… très intéressant !
L’espoir, c’est imaginer que le bien-être ou la "réalisation" se trouvent dans un temps futur sous réserve de changements que l’on souhaite voir s’accomplir avec le risque qu’ils ne s’accomplissent pas. L’espoir est donc intrinsèquement anxiogène et contraire au bonheur immédiat – en ce qu’il déplace la satisfaction, imaginaire, dans le futur, et empêche la satisfaction, réelle, dans le présent.
Le désespoir total consiste à ne plus attendre aucun "meilleur" hypothétique dans le futur ni redouter qu’il n’arrive pas. Le désespoir total est donc la condition sine qua non pour atteindre l’insoutenable légèreté dans l’instant présent.
(D’ailleurs, quiconque a été intensément heureux dans sa vie, d’aussi brefs moments que ce soit, n’aura pas été sans remarquer qu’à cet instant, justement, il n’espérait absolument plus rien…)
euh… punk ?
absolument et totalement désespéré ?
j’ai pas compris !
vous pouvez expliquer ?
Je sens que, quelque part, nous sommes totalement en phase, mon Swâmi! Je n’aurais pas l’outrecuidance de parler pour les autres, mais personnellement, tu me manques beaucoup 🙂
Felicitations pour ta promotion à la grimpe en tête. C’est un tout autre jeu, autant mental que physique, et maîtriser sa peur (ou plutôt l’ecouter et savoir reconnaître quand elle est justifiee) sera sans doute la plus importante chose à apprendre. Mais je n’ai aucun doute que ca te plaira infiniment plus que la moulinette. Pour ma part, affronter cette peur (surtout que j’ai le vertige…) fait partie de ce qui me rend l’escalade si attractive.
Et sinon, je ne fais *jamais* de rappel sans une protection supplementaire avec un noeud à friction auto-bloquant (prusik generalement). C’est un investissement minuscule en temps (15 secondes pour l’installer) et en equipement (quelques euros de cordelette de 6mm et un mousqueton) mais cela apporte une immense securite supplementaire, en bloquant automatiquement la descente si la corde s’echappe de la main. Meme les grimpeurs les plus chevronnes peuvent prendre une pierre sur le casque ou avoir un geste maladroit. Demande a quelqu’un de te montrer, si ce n’est deja fait, et meme si ils t’assurent que c’est inutile, prends l’habitude de l’utiliser, ca ne coute rien.
@Agnès : Merci, je suis touché 🙂
Je suis totalement en phase avec toi, Alexandre. Pour le rappel, comme je l’écris dans le texte, mon binôme m’a enseigné le machard, parce qu’effectivement, je trouve qu’il faut une seconde protection en cas de perte de contrôle.
Sinon, c’est demain soir, le baptême du feu et je suis étrangement assez impatiente. Ensuite, selon la tradition gasconne, on va se faire un énorme festin jusqu’à pas d’heure!
euh…
y’a un truc, je ne sais quoi…
le monsieur il dit : D’ailleurs, quiconque a été intensément heureux dans sa vie, d’aussi brefs moments que ce soit, n’aura pas été sans remarquer qu’à cet instant, justement, il n’espérait absolument plus rien"
il n’espérait PLUS rien…
là, je me demande si ça n’indique pas implicitement qu’avant le bonheur il espérait…
mais bon… ça doit juste parce que je suis un dépressif chronique hein…
@Agnès: ah mince, j’aurais du faire plus attention, je ne connais pas la plupart des termes techniques en francais (j’ai longtemps appele le relais "l’ancre", depuis l’anglais "anchor"…). Du coup pas de soucis. Il y a plein de variantes des noeuds autobloquants, mais pour cette application, n’importe lequel fera l’affaire.
Amuse toi bien demain et n’oublie pas de nous raconter tes nouvelles aventures !
S’il faut, je vais rater une dégaine et ce sera la fin du Monolecte, va savoir 😉
Si c’est le cas, ce sera bon pour les ventes de mon bouquin, ça marche toujours mieux à titre posthume!
Ne t’inquiète pas, Agnés. Je pense que le pire qui puisse t’arriver, c’est de faire un saut et si ton binôme est bon, ton saut sera freiné puis arrêté au dernier noeud fixé (je ne connais pas bien les termes techniques). Bonne séance, alors – raconte-nous !
Ben non, toujours là!
Donc, je suis bien montée en tête hier soir, après la petite formation d’usage (deux instructeurs dévoués pour moi toute seule!) : ne pas mettre le souk sur le baudrier, toujours assurer le brin, respecter le sens des dégaines, être bien stable avant de s’assurer. Ça été fluide, facile et sans soucis. Bon, faut dire que j’étais sur une 4 a ou b, niveau baby, mais bon, c’était une première fois très réussie. Je suis redescendue en rappel en récupérant bien tout mon matériel. Ensuite, on s’est fait une énorme bouffe pour fêter ça 😀
Là, je viens de recevoir un SMS mystérieux :
Dans un premier temps, j’ai pensé à une pub sauvage de Tampax, avant de comprendre que c’était un message de mon binôme qui m’annonçait qu’il avait trouvé le temps de préparer le machard qu’il m’offre en souvenir de ma première montée en tête. Le genre de petites choses qui remonte bien le moral.
En lisant les différentes interventions sur l’escalade, ilme vient une question à propos de vos préoccupations de sécurité.
je me demande si c’est une question de génération ou si c’est moi qui ai un parcours singulier.
en effet, j’ai commencé à grimper dans les années soixante dix. sur des murs et en bloc, donc sans assurance et souvent totalement seul.
c’était courant à l’époque car l’escalade était peu développé en dehors des régions montagneuses ou de certains centres comme fontainebleau.
y’avait ceux qui étaient issus de l’alpinisme ou de la spéléo. ils ne cherchaient pas à faire de l’escalade très fine et étaient effectivement toujours harnachés de pied en cap.
et puis y’avait ceux qui comme moi n’avait pas de matériel, juste des pieds nus ou des basquettes à semelles lisses avant de s’acheter une première paire d’EB.
on grimpait en solo. rarement très haut mais avec un grand savoir faire en matière d’éjection volontaire et de réception. puis on s’est mis à la falaise et à s’équiper. on passait du tire clou au libre intégral et souvent on se faisait des solos dans des voies qu’on connaissait bien. la sécurité était surtout basée sur une grande vigilance bien plus que sur l’utilisation du matériel comme chez les alpinistes. on faisait aussi des séances de vol pour se libérer de l’appréhension de la chute qui génère tétanisation et donc insécurité.
je sais pas si c’est une mentalité qui a perduré ou pas.
je grimpe seul depuis très longtemps maintenant sur une corde fixe et en plongeant en rappel. j’ai jamais mis de machards sur un rappel en falaise. ça se fait effectivement en montagne où les circonstances sont totalement différentes.
mais bon…
à notre époque,on voit les gens faire porter des casques à leurs enfants en vélo et en patins à roulette… alors que quand je me souviens de mon enfance… ben je pense que ma sécurité, j’ai appris à la construire en apprenant à me réceptionner, à me relever et surtout à faire vachement gaffe sans pour autant être tétanisé par le risque, la crainte, le vide, la vitesse, le chaos du relief…
As-tu vu l’Age des possibles, de Pascale Ferran ? Des garçons et des filles en plein gué entre l’enfance (qui s’est prolongée, avec les études et l’insouciance de cette vie) et l’âge adulte, avec ses responsabilités, ses engagements. Au milieu du gué et du film, un très beau texte récité, "La peur". A lire par exemple ici : http://www.menteur.com/rubrik/possi…
L’écriture est superbe. Mais pourquoi" insoutenable"?Dans le roman de Kundera, c’est la légèreté de l’autre qui est insoutenable .Le détachement , la distance que tu prends avec les choses ne gêne personne.
y’a des montagnes dans le Gers ?
des monticules ?
purée faut que je révise ma géographie moi
Joli titre, beau récit, forcément personnel, et déconnecté de ce bas monde où pas mal de sans-papiers qui "n’ont plus rien à perdre" ne sont pas libres pour autant…